André BOROWSKI,
L’Harmattan, Paris, 2021
Recension par David Rand
2025-05-20
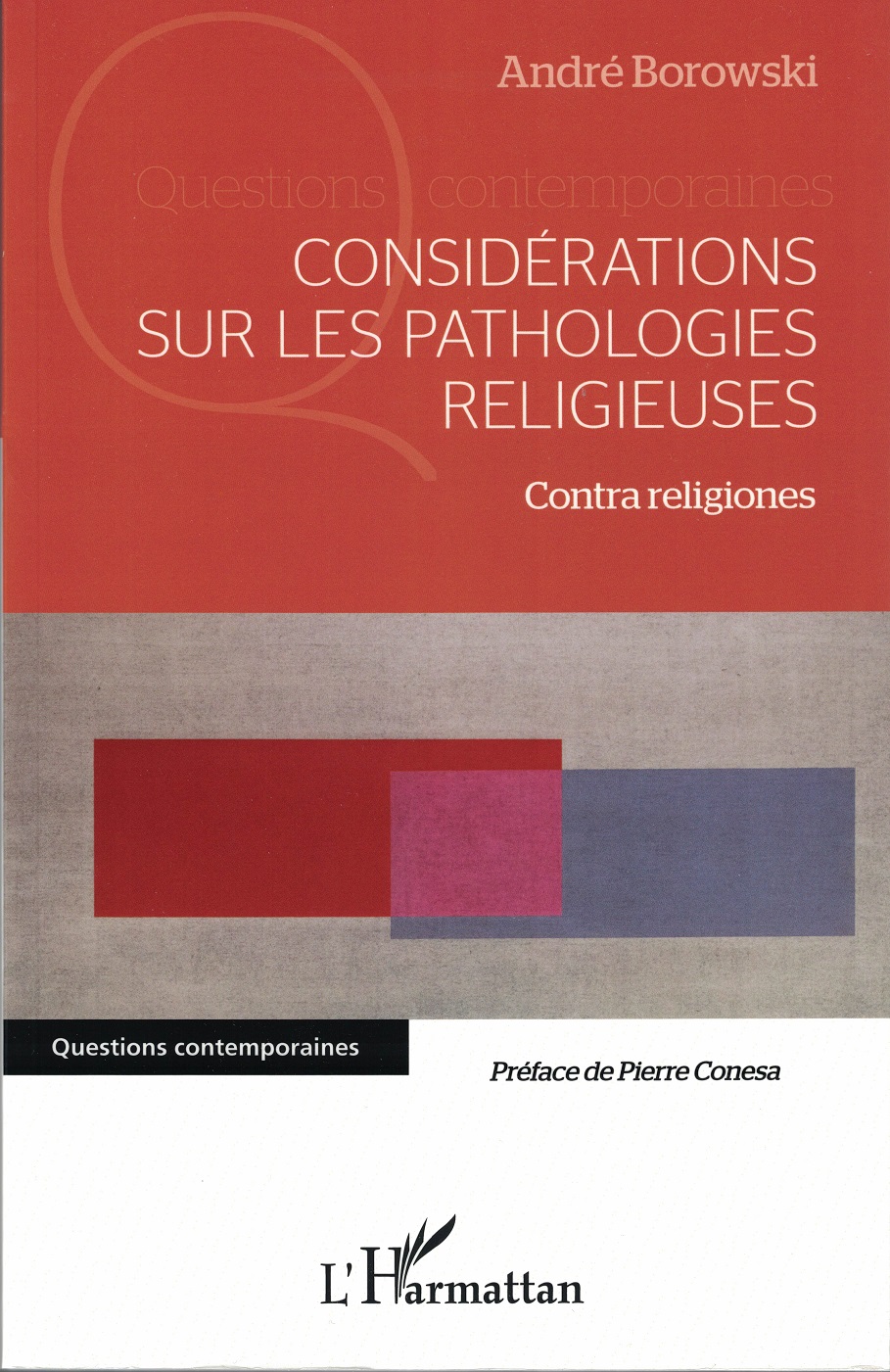
Le volume Considérations sur les pathologies religieuses, de l’auteur genevois André Borowski, est un manifeste antireligieux, un plaidoyer pour la rigueur intellectuelle et une défense de l’épistémologie scientifique, le tout dans un contexte d’une mise en garde contre les atteintes à la liberté de conscience, y compris la liberté de croyance, cette dernière liberté étant une arme majeure contre la croyance. S’il est possible de résumer cette œuvre riche, rigoureuse et remarquable en un seul mot, ce mot serait « épistémologies », c’est-à-dire les méthodes d’acquisition de connaissances, particulièrement les connaissances scientifiques.
Au fait, en matière d’épistémologie, il n’y a qu’une seule, la scientifique. Elle n’est pas nécessairement facile à définir ou à cerner. L’auteur propose l’acronyme FARSIPP, composé des premières lettres des mots falsifiabilité, répétabilité, simplicité, probabilité et prédictibilité, afin de résumer le critères centraux de cette épistémologie. La science est imparfaite et incomplète, ses méthodes sont difficiles et exigeantes, mais elle demeure le meilleur outil, au fait le seul outil fiable, à notre disposition.
Contes de fées
En revanche, les fausses épistémologies, celles qui prétendent apporter une connaissance de notre monde, voire une connaissance exhaustive de tout, mais y échouent complètement, sont nombreuses. L’auteur regroupe celles des religions, basées sur des révélations non répétables et non falsifiables, sous une appellation commune :
Nous appellerons épistémologie contes de fées ou épistémologie mythique, par opposition à une réelle épistémologie, l’“épistémologie” qui est issue de ce mode de pensée. La valeur des contes de fées tient dans la qualité du récit et non dans la vraisemblance du contenu. C’est là tout le problème.
Bien que les croyances religieuses puissent et doivent être vertement critiquées, l’auteur ne s’intéresse pas particulièrement aux dogmes religieux spécifiques, mais plutôt à cette fausse épistémologie qui est à l’origine de la problématique. Ainsi, « il ne peut y avoir de bonnes croyances » puisque leur provenance est fantastique, au sens propre du terme ; ce sont des produits d’une démarche fausse.
Malheureusement, cette épistémologie contes de fées s’accompagne généralement d’un orgueil hypertrophié chez ses partisans, tandis que les scientifiques sont le plus souvent bien modestes. Les scientifiques manquent d’assurance — parce qu’ils connaissent leur sujet !
Si vous avez apprécié le discours décapant de Christopher Hitchens en matière de religion, vous allez admirer la sècheresse et la justesse des tournures de phrases de Monsieur Borowski. En voici quelques petits exemples :
…les religions, tout comme le soda, sont des produits dangereux qu’il faut éloigner des enfants.
…les religions n’expliquent rien, elles divaguent et réconfortent (temporairement).
Le seul avantage des religions, c’est l’épaisseur du rideau de fumée déployé pour masquer l’ignorance et les préjugés.
Si les religions demandent le respect, c’est qu’elles ne le méritent intrinsèquement pas…
Le phénomène religieux doit être traité comme un cas spécial d’addiction.
Le privilège religieux
De tous les privilèges dont jouissent les religions dans nos sociétés, ces privilèges étant nombreux et vastes, le premier et le plus important est sans doute le privilège intellectuel, c’est-à-dire l’idée relativiste, faussement « démocratique », que toute opinion mérite considération. Les religions en tirent un avantage énorme. « [L]a science doit décrire, le moins imparfaitement possible, la réalité. La religion n’a que des problèmes de vraisemblance minimale, et surtout de marketing. » C’est cette situation qu’il faut changer, c’est ce privilège de déférence accordée aux croyances par défaut qui doit cesser.
L’auteur rejette bien sûr le principe NOMA (Non-Overlapping MAgisteria) selon lequel la science et la religion occuperaient chacune son domaine exclusif et propre, éliminant ainsi toute incompatibilité entre elles. Ce principe a été proposé par le paléontologue américain Stephen Jay Gould, qui accordait au domaine religieux le monopole de la morale, dans un but d’évacuer tout conflit et favoriser le respect mutuel entre les deux domaines. Au contraire, l’incompatibilité entre science et religion est évidente et totale, en vertu du rejet par les religions de l’épistémologie scientifique.
D’ailleurs, accorder aux religions l’exclusivité en matière de morale est un geste gratuit et insensé. L’auteur constate que Gould « n’est pas à même, dans ses livres, de donner un seul exemple d’exercice utile de cette pseudo-autorité morale ». De toute façon, « Les règles morales absolues ne valent rien : il faut employer les règles de probabilité et essayer de limiter les impacts négatifs. »
La violence
L’anthropologue mexicano-américain et spécialiste de l’étude de la religion Hector Avalos, dans son œuvre Fighting Words: The Origins of Religious Violence (Mots de combat : les origines de la violence religieuse) observe que les religions créent des ressources virtuelles rares et que cette rareté génère de la concurrence conflictuelle parmi les gens qui croient en l’existence de ces ressources. Ainsi, les religions sont intrinsèquement enclines à la violence, car elles postulent des forces et des êtres dont l’existence est invérifiable. Par conséquent, les différends ne peuvent être résolus par des moyens objectifs, d’où le recours à la violence pour les régler.
L’auteur de Considérations sur les pathologies religieuses fait un constat très semblable. Le fondement mythique, donc arbitraire, des « connaissances » religieuses est générateur de violence.
Le lien très fort qui unit violence et croyance religieuse tient aux spécificités de l’appréhension religieuse du monde. Une divinité, une loi religieuse est par nature éternelle, surplombante, toute-puissante, sans limite. On ne peut abandonner une religion comme on abandonne un territoire parce qu’il devient aride ou parce que des envahisseurs s’en sont emparés pour nourrir leur famille. La croyance religieuse génère spontanément des justifications pour n’importe quelle action, même si elle est violente et dévastatrice ; elle a tous les droits.[…]
C’est donc bien dans l’épistémologie contes de fées que nous trouvons les racines de l’extrémisme religieux. La croyance étant reliée seulement à l’imaginaire humain, elle ne connaît pas de bornes naturelles, pas de démenti par les faits. C’est donc la plus dangereuse des sources de violences collectives.
La laïcité
André Borowski nous propose une vision et une pratique renouvelées de la laïcité, mise à jour et renforcée. Nous ne sommes plus en 1905, année d’adoption de la loi emblématique française de séparation entre la religion et l’État, à une époque où une seule religion, la catholique, constituait une vraie menace en France. En particulier, deux aspects de cette laïcité, la neutralité religieuse et la liberté de croyance, doivent être précisés.
Une vraie neutralité religieuse ne peut pas être seulement défensive, en se contentant de limiter l’incursion du religieux sur l’ensemble du champ social. Elle doit s’accompagner d’une défense active, offensive, de l’épistémologie scientifique à tous les niveaux parce que celle-ci n’a pas de défenseurs professionnels, alors que la foi religieuse dispose d’un personnel nombreux et motivé.[…]
Pour être efficace, elle [la laïcité] doit être offensive et lutter activement contre toutes les croyances religieuses. La meilleure défense, c’est l’attaque.[…]
Or, la liberté de croyance n’est pas un droit absolu à la croyance. C’est le droit à ne pas se faire imposer sa forme de croyance si on est atteint, et le droit de se débarrasser de cette croyance si on y arrive.[…]
[P]our qu’un État soit non confessionnel, véritablement laïque, il ne peut être neutre ou passif en matière religieuse. S’il n’agit pas constamment pour lutter contre les croyances, il risque fort de sombrer du côté d’une croyance particulière.
Au lieu de s’abstenir d’intervenir dans le domaine religieux, l’État se doit d’intervenir, pour des raisons de santé publique, tout comme il peut intervenir pour lutter contre l’abus du tabac, de l’alcool ou de tout autre produit nocif, ou contre les pratiques dangereuses.
La liberté la croyance, la laïcité, ne signifient pas nécessairement non-intervention de l’État dans ce domaine. C’est seulement une manière de faire qui a pu avoir son utilité et qui a pu fonctionner dans certains cas. La liberté de choisir sa marque de bière ne signifie pas que l’État ne peut pas intervenir pour limiter ou combattre la consommation d’alcool. L’outil a été créé pour limiter l’influence délétère d’une religion dominante. à une époque où les religions minoritaires faisaient profil bas et étaient bien contentes qu’on les laisse vivre. La tendance à vouloir à tout prix étendre les droits de tous sans en mesurer les conséquences pratiques produit ce résultat que des religions minoritaires peuvent maintenant, en Occident, avoir un rôle public grandissant et occuper dangereusement l’espace médiatique.
Séparer la croyance de la personne croyante
Ici, au Québec et au Canada, les opposants à la laïcité sont motivés, entre autres, par des idéologies douteuses inspirées du postmodernisme, de la politique identitaire, et du relativisme culturel (que dénonce Monsieur Borowski, en passant). Ces opposants condamnent la très modeste Loi sur la laïcité de l’État (Loi 21), adoptée en 2019, qui ne fait qu’un tout petit pas contre le privilège religieux, mais sans faire la moindre critique explicite des religions. S’il y a un aspect antireligieux à cette Loi, cet aspect est entièrement implicite, sous-entendu dans le souci de freiner le prosélytisme en interdisant le port de signes religieux par des fonctionnaires dans certains contextes bien spécifiques. Pourtant, ces opposants accusent cette Loi — et ceux et celles qui l’appuient — de tous les péchés : discrimination, xénophobie, même racisme.
Que feraient ces antilaïques à propos du programme proposé dans Considérations sur les pathologies religieuses ? Probablement un pétage de plombs, suivi d’une crise d’apoplexie. Ils manquerait de vocabulaire pour décrire leur courroux, ayant épuisé leur stock d’insultes dans un acharnement obsessif contre la Loi 21.
Toutefois, nous savons que toutes ces injures ne sont que fumisterie. En fin de compte, les antilaïques n’ont qu’une seule flèche dans leur carquois : la diffamation. L’auteur rejette catégoriquement ces attaques.
Le problème principal n’est pas la christianophobie, l’islamophobie, la judéophobie, etc., mais la christianofolie, l’islamofolie, la judéofolie[…]
[L]es mouvements religieux veulent faire croire que les peurs plus ou moins légitimes que suscitent les croyances sont automatiquement des actes de discrimination racistes. Rien n’est moins vrai.[…]
Il faut, en utilisant les bons outils, déjouer les propagandes fallacieuses des groupes de croyants qui, à large échelle, au niveau mondial, veulent se faire passer pour des victimes de discriminations injustes, alors que ces populations sont souvent, plutôt, victimes de leur mode de vie non adapté aux échanges à large échelle, ne serait-ce qu’à cause de la présence récurrente de “justiciers” qui sèment régulièrement la terreur au nom de Dieu.
Comme cette loi québécoise qui n’est pas discriminatoire mais seulement disciplinaire — elle n’exclut personne ; elle interdit certains comportements inappropriés dans des situations particulières — l’auteur de Considérations sur les pathologies religieuses insiste fortement sur l’importance de distinguer la croyance de la personne croyante, afin de ne pas tomber dans le piège de persécuter les croyants. Au fait, ce piège, si l’on ne l’évitait pas, mènerait à l’échec de son programme.
Combattre la croyance religieuse sans persécuter les croyants est un acte de santé mentale et sociale indispensable, et non une persécution injuste.[…]
C’est l’effet global de la croyance qui justifie la lutte contre elle, et non un jugement sur chaque personne atteinte. Traiter de fous tous les croyants n’a rien de scientifique. Traiter la croyance de folie humaine a beaucoup plus de sens si l’on en comprend le contexte. L’attaque personnelle sur la folie des croyants n’est donc pas efficace en soi.
…la persécution des croyants n’entraîne pas la disparition des croyances ; il est difficile de mettre une croyance dans un camp de rééducation.
Conclusion
Cette recension ne fait que survoler quelques thèmes majeurs de ce volume dense et détaillé. Il faut le lire au complet pour bien apprécier le programme que propose André Borowski. Laissons le dernier mot à l’auteur :
Pour lutter contre les coutumes « barbares » des autres, il faut se débarrasser des siennes avec les croyances qui les fondent et les renforcent. Ce n’est que par la désignation comme pathologie mentale de l’ensemble des croyances qu’une lutte efficace contre les plus « barbares » (et les autres) pourra être menée efficacement.
Voir aussi : Démarcations séparant les croyances et les connaissances scientifiques, conférence d’André Borowski, 2024-03-09.

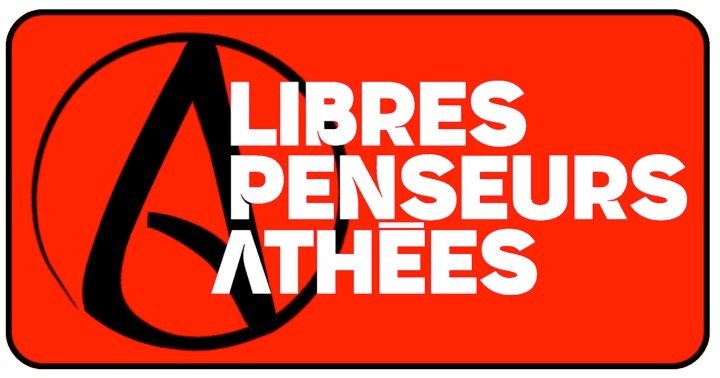
 AFT on Twitter
AFT on Twitter Alliance Athée Internationale (AAI)
Alliance Athée Internationale (AAI) Amis et amies de Libres penseurs athées
Amis et amies de Libres penseurs athées Atheist Freethinkers
Atheist Freethinkers Canal Youtube LPA-AFT
Canal Youtube LPA-AFT LPA-AFT sur Heylo
LPA-AFT sur Heylo Rassemblement pour la laïcité (RPL)
Rassemblement pour la laïcité (RPL)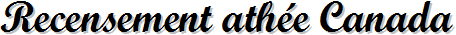 Recensement athée Canada
Recensement athée Canada
Laisser un commentaire